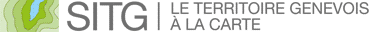Catalogue
Une station de pompage permet de d'élever les eaux d'un niveau à un autre, soit pour le franchissement d'un obstacle, soit en raison de niveaux de collecteurs incompatibles.
Les stations de pompage appartiennent globalement à deux grandes catégories :
1. Les stations de relèvement, destinées à relever les eaux à faible hauteur et sur une courte distance.
2. Les stations de refoulement, destinées à transporter les effluents d'un point à un autre, sur de longues distances et pour vaincre des dénivelés importants.
Ces objets font également partie du produit "Cadastre du réseau d'assainissement des eaux".
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
Cette couche contient autant les ouvrages stockant des eaux pluviales ou usées.
Un bassin de rétention d'eaux pluviales a pour but d'écrêter les débits entrant dans celui-ci, soit en vue d'une protection hydraulique du réseau situé en aval, soit en vue d'une protection du milieu récepteur contre les effets néfastes de déversements d'eaux pluviales urbaines sur son hydrologie naturelle.
Afin de limiter le nombre de déversements d'eaux mélangées dans le milieu récepteur en temps de pluie, il est possible d'installer un ouvrage de rétention sur un réseau unitaire, stockant les déversements lors d'épisode pluvieux et les restituant ultérieurement dans le réseau pour traitement à la station d'épuration.
Le fonctionnement est identique à celui d'un bassin de rétention des eaux pluviales.
Il porte généralement le nom de bassin de stockage-restitution (ou BEP pour bassin d'eaux pluviales, terminologie pouvant prêter à confusion avec un bassin de rétention des eaux pluviales).
Ces objets font également partie du produit "Cadastre du réseau d'assainissement des eaux".
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
Selon la loi fédérale sur les eaux, le mode d'évacuation des eaux pluviales à envisager en première priorité est l'infiltration.
En fonction du contexte géologique, hydrogéologique et de certaines contraintes locales, le territoire est décomposé en quatre secteurs d'infiltration potentielle :
- Ceux dont le potentiel d'infiltration est favorable.
- Ceux dont le potentiel d'infiltration est défavorable.
- Ceux dont le potentiel d'infiltration est à déterminer au cas par cas.
- Ceux au sein desquels toute infiltration des eaux pluviales est interdite (sites pollués, zones instables, etc.).
La Direction générale de l'eau peut exiger pour certains projets une infiltration des eaux pluviales.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
Le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) est un outil communal de planification de l'assainissement.
Le rapport sur l'état des zones de dangers consiste notamment à déterminer le temps que mettrait une source de pollution déversée dans le réseaupour atteindre le milieu naturel ou la station d'épuration.
Les temps de parcours sont exprimés sous la forme de courbes isochrones, ou courbes d'égal temps.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
RESEAU DES ROUTES PRINCIPALES SUISSES (RPS) SUR LE CANTON DE GENEVE
Le réseau des routes principales suisses bénéficiaires d'une subvention fédérale est défini dans l'Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier (OUMin).
Contrairement au réseau de routes principales tel que documenté par l'Ordonnance concernant les routes de grand transit, l'appellation utilisée ici est le réseau des routes principales suisses (RPS). Ces dernières ont en effet une signification dépassant l'échelon régional. Elles relient notamment les régions de montagne et les zones touristiques importantes.
Le Conseil fédéral alloue des contributions financières pour le réseau de routes principales suisses.
L'ordonnance règle les montants et les conditions des cotisations fédérales et donne des principes sur les lignes directrices et les normes pour les projections et l'aménagement des routes principales suisses.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
RESEAU TPG - ARRETS
 | Multi-point
| Multi-point
Les arrêts sont les points de montées et de descentes des passagers sur le réseau de transport collectif genevois.
Les points arrêts portant le même nom, mais pour des lignes différentes se superposent. Visuellement, on ne distingue qu'un seul point mais il peux y en avoir plusieurs.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
RESEAU TPG - HAUBANS
 | Ligne
| Ligne
Cette couche contient l'ensemble des lignes servant de support aux lignes de contact des voies de tramways et de trolleybus du réseau des Transports Publics Genevois
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
RESEAU TPG - LIGNES
 | Ligne
| Ligne
Réseau de lignes de bus, trolleybus et tramways exploités par les Transports Publics Genevois ou par des sous-traitants des Transports Publics Genevois
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
RESEAU TPG - LIGNES DE CONTACT
 | Ligne
| Ligne
Cette couche contient l'ensemble des lignes de contact des voies de tramways et de trolleybus du réseau des Transports Publics Genevois
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
RESEAU TPG - MATS
 | Point
| Point
Mâts porteurs des transversales de support des lignes de contact trolleybus et tramways, 600 Vcc.
Cette classe d'entités est crée à partir des informations des TPG versées au cadastre du sous-sol (classe des noeuds électricité).
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
La schématique des arrêts TPG est issue du regroupement en un seul ponctuel des arrêts (classe TPG_ARRETS , moyenne des coordonnées) et portant le même nom. Ces objets n'ont pas de réalité physique sur le terrain.
Ils sont utiles pour faire des statistiques et autres analyses qui ne requièrent pas la précision associée à la classe d'objet TPG_ARRETS.
Ne pas confondre cette classe d'objet avec TPG_ARRETS
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
RESEAU TPG - SUSPENSIONS
 | Ligne
| Ligne
Cette couche contient l'ensemble des suspensions servant à l'accrochage des lignes de contact des voies de tramways et de trolleybus du réseau des Transports Publics Genevois à leurs haubans.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
RESEAU VIAIRE BILLON (1726-1728)
 | Polygone
| Polygone
La digitalisation du réseau viaire de Billon a été réalisée en deux temps.
Dans un premier temps, le réseau viaire a été obtenu par la soustraction de la couche DPS_BILLON_PARC à un polygone représentant le contour de la ville. Il en a résulté un polygone, qui constitue donc la "négation" de la couche DPS_BILLON_PARC. Ce polygone a ensuite été révisé sur base du plan Billon, afin d'inclure ou d'exclure certains éléments non repris dans le réseau viaire, mais devant y figurer. Certaines routes, allées ou passages ont donc été ajoutés ou supprimés de ce réseau viaire obtenu par négation. Les fontaines et les bâtiments en bois ont également été découpés.
Dans un deuxième temps, le réseau viaire a été étendu à l'extérieur du réseau représenté sur le plan Billon, sur le périmètre des anciennes communes Genève-Cité, Genève-Plainpalais, Genève-Eaux-Vives et Genève-Petit-Saconnex. Pour cela, différentes cartes et couches ont été utilisées : les cartes anciennes de Micheli (1718) et de Mallet (1738) ainsi que la couche du réseau viaire de Céard (DPS_CEARD_VOIRIE) et la couche des fortifications de 1728 (DPS_FORTIFICATIONS_1728). Cette dernière couche a été utilisée pour le tracé des sorties de la ville.
Concernant le réseau viaire extérieur, la présence des routes a tout d'abord pu être confirmée grâce aux plans Micheli et Mallet. Si leur tracé semblait identique à celui de l'époque de Céard, le tracé de la couche du réseau viaire de Céard a été conservé. Sinon, les cartes de Mallet et de Micheli ont été utilisées pour la vectorisation des routes.
Cette couche a été créée en 2012 par Giancarlo Ghilardi dans le cadre d'une convention de stage passée avec le département de Géographie de l'Université de Genève pour le Certificat complémentaire en Géomatique. Elle a été révisée et complétée en 2014 par Florence Herickx, dans le cadre de la même convention de stage.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
RESEAU VIAIRE CEARD (1837-1840)
 | Polygone
| Polygone
La digitalisation du réseau viaire de Céard a été réalisée en deux temps.
Dans un premier temps, le réseau viaire a été obtenu par la soustraction de la couche DPS_CEARD_PARC à un polygone représentant le contour de la ville. Il en a résulté un polygone, qui constitue donc la "négation" de la couche DPS_CEARD_PARC. Ce polygone a ensuite été révisé sur base du plan Céard, afin d'inclure ou d'exclure certains éléments non repris dans le réseau viaire, mais devant y figurer. Certaines routes, allées ou passages ont donc été ajoutés ou supprimés de ce réseau viaire obtenu par négation. Les fontaines et les bâtiments en bois ont également été découpés.
Dans un deuxième temps, le réseau viaire a été étendu à l'extérieur du réseau représenté sur le plan Céard, sur le périmètre des anciennes communes Genève-Cité, Genève-Plainpalais, Genève-Eaux-Vives et Genève-Petit-Saconnex. Pour cela, différentes cartes et couches ont été utilisées : deux cartes Dufour datant de 1837-1838, l'Atlas du territoire de 1800, la couche du réseau viaire de Grange (DPS_GRANGE_VOIRIE) et la couche des fortifications de 1728 (DPS_FORTIFICATIONS_ 1728). Cette dernière couche a été utilisée pour le tracé des sorties de la ville.
Concernant le réseau viaire extérieur, la présence des routes a tout d'abord pu être confirmée grâce aux plans Dufour. Si leur tracé semblait identique à celui de l'époque de Grange, le tracé de la couche du réseau viaire de Grange a été conservé. Sinon, la carte de l'Atlas du territoire de 1800 a été utilisée pour le dessin précis des routes, son géoréférencement étant plus précis que celui des cartes Dufour.
Cette couche a été créée en 2012 par Giancarlo Ghilardi dans le cadre d'une convention de stage passée avec le département de Géographie de l'Université de Genève pour le Certificat complémentaire en Géomatique. Elle a été révisée et complétée en 2014 par Florence Herickx, dans le cadre de la même convention de stage.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
RESEAU VIAIRE GRANGE (1896-1911)
 | Polygone
| Polygone
La digitalisation du réseau viaire de Grange a été réalisée en deux temps.
Dans un premier temps, le réseau viaire a été obtenu par la soustraction de la couche DPS_GRANGE_PARC à un polygone représentant le contour de la ville. Il en a résulté un polygone, qui constitue donc la "négation" de la couche DPS_GRANGE_PARC.
Ce polygone a ensuite été révisé sur base du plan Grange, afin d'inclure ou d'exclure certains éléments non repris dans le réseau viaire, mais devant y figurer. Certaines routes, allées ou passages ont donc été ajoutés ou supprimés de ce réseau viaire obtenu par négation. Les fontaines ont également été découpées.
Dans un deuxième temps, le réseau viaire a été étendu à l'extérieur du réseau représenté sur le plan Grange, sur le périmètre des anciennes communes Genève-Cité, Genève-Plainpalais, Genève-Eaux-Vives et Genève-Petit-Saconnex.
Pour cela, deux plans ont été utilisés : la carte de l'Atlas du territoire des XIXe et XXe siècles (Territoire XIX-XX) et la carte Siegfried (2e édition, 1898-1915). Le premier, permettant une correspondance assez précise avec le cadastre routier actuel, a servi de base pour le dessin précis des routes. Le second a, quant à lui, permis de confirmer la présence des différentes routes à la période de Grange, mais n'a pas été utilisé pour le dessin des routes, son géoréférencement étant moins précis que celui de l'Atlas du territoire.
Cette couche a été créée en 2012 par Giancarlo Ghilardi dans le cadre d'une convention de stage passée avec le département de Géographie de l'Université de Genève pour le Certificat complémentaire en Géomatique. Elle a été révisée et complétée en 2014 par Florence Herickx, dans le cadre de la même convention de stage.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service