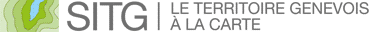Catalogue
RDPPF - ZONES PROTEGEES
 | Polygone
| Polygone
Les zones protégées
sont définies aux articles 28 et 29 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT).
Les zones protégées sont les suivantes:
- la zone de la Vieille Ville et du secteur sud des anciennes fortifications.
Ces données font partie du cadastre des restrictionws de droit public à la propriété foncière (RDPPF) dans le domaine de l'aménagement du territoire, catégorie des plans d'affectation.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
SYNTHURBA - MODIFICATIONS DE ZONE
Uniquement partenaires SITG | PolygoneLes modifications de limite de zone (MZ) modifient le plan de zone, plan d'affectation général qui définit les règles de constructions par zones pour l'ensemble du territoire cantonal. La couche SYNTHURBA_MZ recense les MZ à l'étude ou en cours de procédure et les MZ adoptées disposant encore d'un potentiel à bâtir.
Les périmètres sont représentés. Les informations disponibles sont extraites des écrans synoptiques, suivi, statistiques, synthèse de la base de données SYNTHURBA (SYNTHESE URBANISATION) : elles permettent d'identifier la dénomination, l'avancement ou les capacités d'accueil, initiales et restantes des MZ.
SYNTHURBA - PLANS DIRECTEURS DE ZONE INDUSTRIELLE
Uniquement partenaires SITG | PolygoneLes plans directeurs en zone de développement industriel (PDZI) sont des plans d'affectation spéciaux qui prescrivent les règles d'aménagement dans les zones de développement industriel (voirie, infrastructures...). La couche SYNTHURBA_PDZI recense les PDZI à l'étude ou en cours de procedure et les PDZI asoptés disposant encore d'un potentiel à bâtir.
Les périmètres sont représentés. Les informations disponibles sont extraites des écrans synoptiques, suivi, statistiques, synthèse de la base de données SYNTHURBA (SYNTHESE URBANISATION) : elles permettent d'identifier la dénomination, l'avancement ou les capacités d'accueil, initiales et restantes des PDZI.
PLAN DIRECTEUR CANTONAL - HAMEAUX EN ZONE AGRICOLE (points)
Consultation par géoservices | PointPierre angulaire de l'aménagement du territoire, le plan directeur cantonal pose les grands principes et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement du canton de Genève.
Soumis à l'approbation de la Confédération, le plan directeur cantonal 2030 (PDCn) assure la coordination et la cohérence entre les politiques sectorielles, il détermine les mesures d'aménagement nécessaires en matière d'urbanisation, de mobilité, de gestion de l'espace rural, des milieux naturels et des ressources.
Engageant pour les autorités pour lesquelles il a force obligatoire, il règle la coordination entre les politiques d'aménagement du canton et de la Confédération, des cantons voisins et des régions limitrophes. Il fournit le cadre à l'aménagement local et aux activités qui sont de la compétence des communes.
L'enjeu majeur du PDCn est de proposer un projet de territoire qui respecte l'équilibre entre le développement des activités humaines et une gestion durable du territoire. Il s'agit d'offrir une réponse aux besoins en logements, activités, mobilité, équipements, services, loisirs et espaces publics, tout en préservant et valorisant patrimoine bâti, paysager et naturel, les terres cultivables et la qualité de vie.
Le PDCn a été adopté par le Grand Conseil le 20 septembre 2013 et approuvé par le Conseil fédéral le 29 avril 2015. Il a fait l'objet d'une première mise à jour adoptée par le Grand Conseil le 10 avril 2019 et approuvée par la Confédération le 18 janvier 2021. Cette première mise à jour a permis d'adapter le PDCn aux nouvelles directives fédérales accompagnant l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT1) et de lever certaines réserves émises par la Confédération lors de son approbation en 2015.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
BIEN-FONDS D'ARBRES D'ORNEMENTS
 | Polygone
| Polygone
Cette couche consiste à adapter le classement de l'USSP (Union Suisse des Services des Parcs) concu pour l'échelle communale, à l'échelle cantonale. Le Canton de Genève, en tant que canton-ville, rend cette adaptation d'échelle plus simple: le type de zone peut être défini par les zones d'affectations en vigueur.
Les utilisateurs peuvent utiliser cette couche pour calculer la situation du bien-fonds pour les calculs des valeurs compensatoires lors d'abattage lié à un projet de construction.
Référence normes de l'USSP de 1974.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
INVENTAIRE BATIMENTS POTENTIELLEMENT SOUMIS A MESURES DE PROTECTION
Uniquement partenaires SITG | PolygoneSous cette dénomination sont regroupés:
- les bâtiments soumis à des mesures de protection, dans le cadre de la loi cantonale sur la protection des monuments et des sites (LPMNS) du 4 juin 1976,
- les bâtiments situés en zone protégée (périmètre protégé ou zone 4BP),
- les bâtiments construits avant 1945.
Cet inventaire n'est pas exhaustif; il s'agit d'un outil indicatif qui permet une préorientation rapide dans le cadre des procédures liées à l'énergie.
Certains bâtiments désignés peuvent ne pas être protégés (bâtiment sans intérêt au sein d'une zone protégée), et d'autres, non désignés le sont (bâtiment recensé, mais n'ayant pas encore fait l'objet d'une procédure de protection).
MOUVEMENT PERMANENT
 | Polygone
| Polygone
C'est sur la base de la carte des zones instables représentant les phénomènes géologiques d'instabilité du canton et souvent des observations complémentaires de longues durée, qu'ont été définis les territoires en mouvement permanent décrits dans les article 660a du code civil suisse et 71A de la loi d'application du code civil et du code des obligations.
Les zones appelées mouvement permanent sur la carte des zones instables correspondent ainsi à l'alinéa 2, article 71A Glissements de terrain . C'est-à-dire que les immeubles situés dans ces zones seront mentionnés au registre foncier.
Ces territoires en mouvement permanent correspondent aux glissements les plus importants du canton de Genève. En effet, ces vastes zones sont généralement suivies depuis des décennies et ont toujours montré des mouvements susceptibles de provoquer le déplacement de tout un secteur foncier et, dès lors, nécessitent la mention zone instable.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
NIVEAUX DE TOLERANCE SELON OMO ET OTEMO
 | Polygone
| Polygone
Pour les besoins de la mensuration officielle, conformément à l'OMO et l'OTEMO, le territoire de la Confédération est réparti en régions de niveaux de tolérances.
Ces régions de niveaux de tolérances régissent les exigences cantonales relatives à la précision et à la fiabilité des données des différentes couches cadastrales. Pour cela, le territoire cantonal est divisé en deux régions de niveaux de tolérances :
- NT2 (niveau de tolérance 2) : zones bâties, à bâtir
- NT3 (niveau de tolérance 3) : autres zones
La mise à jour est assurée périodiquement en fonction des modifications des zones d'affectation mises en vigueur par le département du territoire (DT)
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
RDPPF - DEGRES DE SENSIBILITE AU BRUIT
 | Polygone
| Polygone
La lutte contre le bruit est un objectif inscrit dans la Constitution fédérale.
L'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) fixe quatre degrés de sensibilité (DS)
- DS I zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit
- DS II zones n'autorisant aucune entreprise gênante
- DS III zones acceptant les entreprises moyennement gênantes
- DS IV zones acceptant les entreprises fortement gênantes
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WMS : accéder au service
RDPPF - PERIMETRES NATURELS PROTEGES
 | Polygone
| Polygone
Les zones protégées
sont définies aux articles 28 et 29 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT).
Les zones protégées sont les suivantes:
- le site du Rhône, selon la loi sur la protection générale desrives du Rhône, du 27 janvier 1989
- les rives du lac, selon la loi sur la protection générale des rives du lac, du 4 décembre 1992
- les rives de l'Arve, selon la loi sur la protection générale et l'aménagement des rives de l'Arve, du 4 mai 1995
Ces données font partie du cadastre des restrictionws de droit public à la propriété foncière (RDPPF) dans le domaine de l'aménagement du territoire, catégorie des plans d'affectation.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
SURFACES D'ASSOLEMENT
 | Polygone
| Polygone
Les surfaces d'assolement (SDA) font partie du territoire qui se prête à l'agriculture. Elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables.
L'objectif est d'aider à l'examen des requêtes en zone agricole et de gérer les surfaces dans le but de la préservation des SDA.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
La couche des bâtiments (polygones) est produite à partir :
-côté francais, de la BD TOPO® de l'IGN dans sa version 2.2, édition 18.2, septembre 2018,
-thème bâti, couches du bâti industriel, du bâti remarquable et du bâti indifférencié, de type polygonal
-thème zone d'activité, couches des pai_science_enseignement et pai_santé, de type ponctuel
-projetées en Lambert 93 (référence officielle francaise), sélection périmètre du Grand Genève, pour les objets des départements de l'Ain, du Jura et de la Haute Savoie.
-côté genevois, de la base du SITG dans sa version d'exploitation/métier en date du 15/08/2019, couche cad_batiment_hors_sol, de type polygonal projetée en CH1903+_LV95 (ou EPSG=2056, référence officielle suisse), sans sous-sélection.
-côté vaudois, des couches MOVD_CAD_TPR_BATHS_S_polygon et NPCS_CAD_TPR_BATHS_S_polygon de février 2019 de type polygonal projetée en CH1903+_LV95 (ou EPSG=2056, référence officielle suisse), sélection: périmètre du Grand Genève.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
AGGLO - CARROYAGE DE POPULATION
Consultation par géoservices | PolygoneSelon l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), un carroyage est un découpage de l'espace géographique en mailles régulières de forme carrée et de taille fixe. Construits sans a priori sur ce que doivent être les zonages d'intervention ou de gestion, les carroyages permettent une vision impartiale des phénomènes et sont naturellement à même de mettre en évidence les zones à enjeu.
Les données carroyées de population sont construites à partir des données INSEE et OFS. Ainsi, les carreaux ne sont pas de taille homogène : la maille est de 200 mètres x 200 mètres côté francais et 100 mètres x 100 mètres côté suisse.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
AGGLO - CARROYAGE DE POPULATION ET EMPLOIS
 | Polygone
| Polygone
Selon l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), un carroyage est un découpage de l'espace géographique en mailles régulières de forme carrée et de taille fixe. Construits sans a priori sur ce que doivent être les zonages d'intervention ou de gestion, les carroyages permettent une vision continue des phénomènes et sont naturellement à même de mettre en évidence les zones à enjeu. Depuis 2021, le Grand Genève est doté d'une grille homogène et continue de 166'792 carreaux de 200 m (dont 55'438 sont situés au sein du Grand Genève). Le carroyage Grand Genève permet notamment une lecture localisée de la densité (habitants ou emplois / ha) et mixité fonctionnelle (part de l'emploi sur la somme des emplois et des habitants) ou d'autres analyses localisées à l'échelle infra communale. Par contre, cette donnée n'est pas indiquée pour la réalisation d'agrégations par divisions administratives transfrontalières, pour lesquelles les statistiques de l'Observatoire Statistique Transfrontalier (OST, https://www.ge.ch/statregio-francosuisse/) constituent la référence.
Les données carroyées de population et d'emplois du Grand Genève sont construites à partir des données INSEE et OFS. Les sources sont les suivantes:
Suisse
- population: STAPOP, 2019;
- emplois: STATENT, 2019.
France
- population: FiLoSoFi, 2019;
- emplois: estimation réalisée par le Pôle métropolitain du genevois francais sur la base des données SIRENE, 2020. Cette base localise à l'adresse et classe les entreprises en fonction de leur taille (rangs de nombre d'employés).
Le millésime 2019 retenu pour la population correspond à la dernière version disponible pour la France et permet donc des comparaisons transfrontalières en matière de densités d'habitants. Par contre, les données d'entreprises géoréférencés en France (SIRENE) ne sont pas disponibles de manière suffisamment fiable avant 2020. Il est prévu d'actualiser les données de population et d'emplois dès que le prochain millésime du carreau de population sera mis à disposition par l'INSEE.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
AGGLO - CARTE DE SYNTHESE DES DANGERS ET ALEAS DUS AUX CRUES
Consultation par géoservices | PolygoneCette carte fournit une vue synthétique des données relatives aux dangers/aléas liés aux crues des cours d'eau à l'intérieur du périmètre de l'agglomération Franco Valdo Genevoise.
Cette carte n'intègre pas l'extension de la zone inondable conditionnelle selon la terminologie Suisse.
Cette couche est obtenue pas juxtaposition des données découpées selon la limite de chaque entité territoriale.
Les données figurant dans cette carte ne peuvent se substituer à la donnée originale.
L'information n'a pas été collectée pour les communes ne disposant pas de cartes de dangers/aléas et pour celles où le zonage des risques d'inondation est en cours de révision.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service