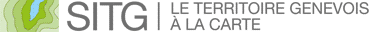Catalogue
INONDATION TEMPS DE RETOUR 300 ANS
 | Polygone
| Polygone
Par inondation, on entend le débordement d'un cours d'eau hors de son lit. Le caractère plus ou moins dangereux des inondations dépend de la hauteur d'eau et de la force du courant atteinte, ainsi que de la quantité de matériaux charriés.
La détermination des zones d'inondation se fait par rapport à la topographie. Pour certaines zones, l'apparition d'inondations dépend de conditions particulières concomitantes au déroulement de l'évènement de crue, comme: les embâcles sous les ponts et passerelles, la rupture d'un ouvrage de protection ou les courbes de remous aux points de confluence des cours d'eau ou du lac.
Les périodes de retour pour lesquelles les zones d'inondation ont été déterminées sont de 30, 100 et 300 ans et pour certains cours d'eau 2 et 10 ans. Les zones d'inondation conditionnelle sont représentatives des conditions particulières décrites ci-dessus.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
La Suisse est un lieu d'hivernage et de repos particulièrement important pour diverses espèces d'oiseaux d'eau migrateurs.
Conscient de cette importance, le Conseil fédéral a signé en 1974 la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, conclue à Ramsar en 1971 et ratifiée par l'Assemblée fédérale en 1975.
Un inventaire des réserves d'oiseaux d'eau d'importance internationale pour la Suisse a été élaboré en 1976 sur la base de critères antérieurs.
La Station ornithologique de Sempach a présenté une version révisée de cet inventaire, comprenant aussi les objets d'importance nationale.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
La zone protégée comprend 3 objets : les rives gauches et droites du lac Léman, ainsi que l'ensemble du cours du Rhône depuis la rade de Genève jusqu'à la frontière francaise à Chancy.
Objectif
Conservation de la zone en tant que lieu de repos et de nourriture pour les oiseaux d'eau y passant l'hiver.
Mesures particulières de protection des espèces
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
MACROPHYTES DU LAC - HERBIER
 | Polygone
| Polygone
La végétation aquatique immergée, incluant les plantes vasculaires et les characées a été recensée du 11 juillet au 15 août 2016 dans le littoral genevois du Léman.
Jusqu'à une profondeur de 10 mètres, la végétation a été recensée depuis un bateau à l'aide d'un râteau. Plusieurs plongées subaquatiques ont permis de compléter les relevées dans des zones portuaires peu praticables, sur les monts de Corsier et sur la beine lacustre au-dessous de 8 mètres de profondeur jusqu'à la limite de colonisation des végétaux.
La localisation, la composition floristique et le taux de recouvrement sont déterminés de manière à pouvoir attribuer à chacun, des polygones détourés sur la carte et un nom d'association végétale selon le référentiel Phytosuisse et les classes de densité utilisées en Suisse.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
MARQUAGES ROUTIERS - SURFACES SPECIFIQUES
 | Polygone
| Polygone
Cette couche fait partie du cadastre des marquages routiers, mis à disposition dans le groupe de couches 'MARQUAGES ROUTIERS'.
La couche "SURFACES SPECIFIQUES" contient des surfaces tels que les zones teintées au sol (zone cyclable, site propre de transport en commun, surface de modération de trafic) incorporé dans le sol.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
MISES A BAN
 | Polygone
| Polygone
Les mises à ban, (du verbe bannir) constituent - comme leur nom l'indique et par homologie avec la pratique de protection des cultures en zone agricole (vignoble notamment) - des surfaces interdites d'accès pour une durée déterminée en cours d'année.
La pénétration par l'homme et les animaux domestiques (chiens surtout) est proscrite pour des raisons de protection de la flore et/ou de la faune en période sensible (floraison, nidification, etc).
Utilisée dans une optique de protection de la nature, cette disposition (réglement L 4 05.08 est une particularité du canton de Genève.
Les emplacements mis à ban sont déterminés chaque année par arrêté du Conseil d'état et signalés sur le terrain par des panneaux.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
Le Modèle Numérique de Surface (MNS) ou Modèle numérique d'Elévation (MNE) est un modèle tridimensionnel représentant, sous forme numérique, le relief d'une portion de territoire, incluant les bâtiments et la végétation.
Ce MNS est le résultat de l'agrégation d'une acquisition LiDAR datant de 2013 pour la partie Suisse du Grand Genève et de 2014 pour la partie Française. Cela peut expliquer certaines incohérence sur les zones proches de la frontière, par exemple sur les zones en chantier.
Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) ou Modèle numérique d'Elévation (MNE) est un modèle tridimensionnel représentant, sous forme numérique, le relief d'une portion de territoire, incluant les bâtiments et la végétation.
Ce MNT est le résultat de l'agrégation d'une acquisition LiDAR datant de 2013 pour la partie Suisse du Grand Genève et de 2014 pour la partie Française. Cela peut expliquer certaines incohérence sur les zones proches de la frontière, par exemple sur les zones en chantier.
Le modèle régional profond (2019) est le résultat d'un travail de modélisation géologique à l'échelle régionale des unités principales de l'intervalle du Mésozoïque, réalisé par l'Université de Genève.
Ce modèle a été établi sur la base de l'état des connaissances du moment et s'appuie sur les données géophysiques (sismique réflexion) acquises sur le territoire jusqu'en 2016, ainsi que sur les données de forage disponibles jusqu'en 2018.
Différentes cartes ont été générées depuis ce modèle régional tridimensionnel et sont à disposition sur le portail du SITG. 2 types de produits y sont proposés:
1. Les données de bases (ayant servi à la construction du modèle géologiques 3D)
2. Les cartes géologiques (produits cartographiques extraits du modèle géologique 3D)
Le produit "Données de base" est constitué des couches suivantes :
- Forages utilisés dans le cadre du projet
- Lignes sismiques 2D
- Zone modélisée.
Par définition, un modèle géologique propose une vision et interprétation non-unique de la réalité qui, selon la sensibilité du modélisateur ainsi que la quantité, répartition et qualité des données et connaissances sur lesquelles il s'appuie, peut varier d'un auteur à l'autre.
Par ailleurs, ce type de modèle et les produits cartographiques qui en découlent sont inévitablement emprunts d'un certain degré d'incertitude inhérent au processus de modélisation géologique. Celui-ci résulte principalement du cumul des sources d'incertitude liées à la qualité et répartition des données de base, à leur interprétation et interpolation en 3 dimensions, ainsi qu'à la conversion en profondeur des objets modélisés.
NUAGES DE POINTS LIDAR 2021 (LiDAR)
 | Produit
| Produit
LIDAR (acronyme anglais de Light Detection And Ranging, détection et télémétrie par ondes lumineuses) est une technique de télédétection optique qui utilise la lumière laser en vue d'un échantillonnage dense de la surface de la Terre, et produit des mesures 3D d'une grande précision.
Les données LIDAR produisent des jeux de données de nuage de points cotés.
Les données LiDAR 2021 de l'Etat de Genève sont issues d'un mandat de recherche sur une zone restreinte aux communes de Thônex et de Chêne-Bourg.
Elle ont la particularité d'avoir une haute densité de 175-220 points au mètre carré. La précision altimétrique est de +/- 4 cm sur surface dure et la précision planimétrique est estimée à 8cm environ.
Date de vol : 10 mars 2021
Une classification succincte a été réalisée automatiquement à partir des données LiDAR 2019.
Chaque point est classifié selon une classe dont les principales sont :
- 1 - Non classifié
- 2 - Sol
- 3 - Basse végétation (<50cm)
- 5 - Haute végétation (>50cm)
- 6 - Bâtiments
- 7 - Points bas ou isolés
- 9 - Eau
- 13 - Ponts, passerelles
- 15 - Sol (points complémentaires)
- 16 - Bruit
- 19 - Points mesurés hors périmètre de l'acquisition
OUVRAGE DE GESTION DES CRUES (Surfaces)
 | Polygone
| Polygone
OUVRAGE DE TYPE SURFACIQUE DE GESTION DES CRUES
Cette couche resense les ouvrages de gestion des crues, tels que les bassins de rétention à ciel ouvert, zones d'expansion des crues, etc. En général, une photo illustre l'ouvrahe.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
PERIMETRE STICK'AIR POUR CIRCULATION DIFFERENCIEE
Consultation par géoservices | PolygoneLe périmètre de circulation différenciée représente la zone où une restriction de circulation s'effectue lors d'un épisode de smog. L'autorisation de circuler dans ce périmètre se base sur les performances environnementales des véhicules par le biais du macaron Stick'AIR, décliné en 6 catégories (de 0 à 5).
Ce périmètre est en vigueur dès le 15 janvier 2020.
Le plan d'implantation des sondes géothermiques verticales est effectuée sur la base des modèles des formations attribuées au sommet du toit de l'imperméable (molasse + riss) et du toit de l'alluvion ancienne. Celui-ci est divisé en deux zones.
La première zone représente les lieux où l'implantation de sondes géothermiques est interdite en raison de la présence de nappes d'eau souterraines du domaine public.
La deuxième zone indique les endroits où il est nécessaire de demander, auprès du service de géologie sols et déchets (GESDEC) des renseignements complémentaires.
Remarque importante
Le requérant est tenu de vérifier que l'implantation et la profondeur des forages sont compatibles avec d'éventuelles installations enterrées existantes (canalisations, galeries, tunnels, ancrages, etc).
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
Les chemins de randonnée pédestre constituent un réseau de chemins interconnectés destinés au délassement qui dessert notamment les zones propices à la détente : la campagne, les milieux naturels, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques.
Librement accessibles et favorisant le tourisme rural, les chemins de randonnée pédestre sont signalisés au moyen de panneaux jaunes conformément à la norme VSS 640 829a « Signalisation du trafic lent » et devraient en principe être munis d'un revêtement naturel (gravier, terre, herbe).
Les chemins de randonnée pédestre sont régis par la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre LCPR 704 (4 octobre 1985) et par la loi cantonale sur l'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LaLCPR L 1 60).
La législation prévoit que le réseau de chemins de randonnée pédestre fasse l'objet d'une planification directrice, mise à jour en principe tous les dix ans.
Le premier plan directeur des chemins de randonnée pédestre du canton de Genève (PDCRP) est entré en vigueur en 2002 et a été révisé en 2018.
Cette révision du plan directeur a permis d'intégrer les corrections du réseau rendues nécessaires suite aux modifications imposées par l'évolution du trafic et par les nouvelles planifications directrices. Le plan directeur a été établi en coordination avec le canton de Vaud et tient compte des liaisons existantes avec la France voisine.
Le plan directeur des chemins de randonnée pédestre définit notamment :
- la géographie du réseau
- les types de revêtements (chemins goudronnés, naturels ou présentant un revêtement mixte)
- le tracé des cheminements dont la réalisation est souhaitable
- le tracé des cheminements dont l'amélioration des infrastructures est souhaitable
- le tracé des cheminements à supprimer.
Toute modification du revêtement d'un chemin inscrit au plan directeur des chemins de randonnée pédestre ou sa suppression est soumise à approbation du département du territoire.
La maintenance de la signalisation selon les directives fédérales est assurée par l'association Genève Rando.
Hormis le réseau inscrit au plan directeur, les chemins de liaison et les boucles transfrontalières sont aussi présents à titre indicatif.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
PLAN DIRECTEUR DES GRAVIERES
 | Polygone
| Polygone
Le plan directeur des gravières est un document qui fixe la politique suivie par le canton en matière d'exploitation des gravières. Il définit, notamment au moyen de cartes, les secteurs où l'extraction de gravier est envisageable. Ce document lie les autorités cantonales et communales mais n'engage pas les propriétaires fonciers et les particuliers.
Le plan directeur présente deux types de zones:
la zone d'exploitation,
qui définit des surfaces pour lesquelles la procédure de demande d'ouverture d'une gravière peut s'engager sans délai.
la zone d'attente,
qui définit des surfaces pour lesquelles les infrastructures de transport sont actuellement insuffisantes pour permettre une exploitation.
Il à été adopté par le Conseil d'Etat en 2010.
Concu comme un outil de gestion pour l'exploitation des graviers dans le canton de Genève, le nouveau plan directeur intègre ces nouvelles contraintes liées à l'environnement et à l'aménagement du territoire.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service