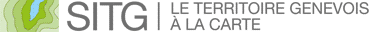Catalogue
CARTE DE LA VEGETATION AU 1:25000
 | Polygone
| Polygone
CARTE DE LA VEGETATION AU 1:25000 DU CANTON DE GENEVE
Synthèse au 1:25'000 des cartes de végétation par commune réalisées de 1981 à 1991 par Karl Werdenberg et Pierre Hainard lors d'une collaboration entre le Laboratoire de Biogéographie de l'Université de Genève et le Service des Forêts, de la Faune et de la Protection de la Nature du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture de l'époque.
Ces cartes se limitent aux milieux naturels et ne sont donc pas couvrantes.
Cette carte est accompagnée de la publication d'une Série Documentaire N° 34 des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
ECOMORPHOLOGIE DES COURS D'EAU
 | Ligne
| Ligne
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (EAWAG) ont élaboré une méthode d'analyse pour l'appréciation écomorphologique des cours d'eau en Suisse.
Cette méthodologie a été publiée dans les cahiers de 'L'environnement pratique - Informations concernant la protection des eaux', no 27 en 1998.
L'écomorphologie est une méthode d'appréciation de l'état naturel des cours d'eau par troncons homogènes. Le relevé est fait sur la base de 5 critères: la largeur du lit, la variabilité de la largeur du lit mouillé, l'aménagement du fond du lit, le renforcement du pied de la berge et la largeur et nature des rives.
L'appréciation classe le troncon selon 4 catégories représentées par un code couleur:
- bleu = naturel, semi-naturel
- vert = peu atteint
- jaune = très atteint
- rouge = non naturel, artificiel
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
EMPLACEMENT CAMPING AUTORISE
 | Point
| Point
Le canton de Genève bénéficie d'une campagne comportant des milieux naturels et agricoles propices aux activités de tourisme rural, dont la pratique du camping fait partie.
La législation genevoise fait la distinction entre les installations qui sont soumis au règlement sur les campings L 5 05.20, soit les campings ouverts au public, de même que les campings privés n'acceptant que des sociétaires et les emplacements qui ne sont pas soumis à ce règlement.
Pour ce qui est de la pratique du camping en dehors des installations soumises au règlement sur les campings, la situation est la suivante:
• Le camping sauvage est généralement interdit, sauf autorisation;
• Le camping en forêt est expressément interdit, sauf sur les emplacements prévus à cet effet, et avec autorisation délivrée par l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN);
• Le parcage de remorque et véhicules de campings sur les places de parc et sur la voie publique de certaines communes n'est autorisé que pour une durée inférieure à 24h;
• Le camping sur le domaine public est soumis à autorisation de la collectivité publique qui l'administre;
• Le camping sur le domaine privé est subordonné à l'autorisation du propriétaire.
Cette classe d'entités référence les installations soumises au règlement sur les campings ouverts au public ou réservés au sociétaires, ainsi que les emplacements où le camping est toléré en forêt sous réserve de l'obtention d'une autorisation préalable de l'OCAN.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
ESPACES POUR CHIENS EN LIBERTE
 | Polygone
| Polygone
La divagation des chiens mal maîtrisés cause de graves perturbations à la faune sauvage, qui peuvent aller de la mise en fuite à la poursuite, la capture et même la mise à mort d'animaux.
Les expériences ont montré qu'il était souhaitable de créer des espaces dans lesquels les chiens peuvent s'ébattre sans être tenus en laisse tout en restant sous le contrôle permanent de leur maître.
Afin de favoriser de bonnes conditions d'existence pour les animaux de compagnie , l'OCAN a examiné tous les massifs boisés et propose un certain nombre d'espaces en forêt où il est possible d'accueillir les chiens en liberté sans causer d'impact grave sur la faune.
Ces espaces sont répartis dans tout le canton mais surtout à proximité des agglomérations.
Enfin cette classe d'objet contient également les espaces proposés par les communes.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
FONCTION DU PLAN DIRECTEUR FORESTIER
 | Polygone
| Polygone
Le Plan Directeur Forestier représente le faîte de la planification forestière. Il vise à défendre les intérêts publics propres à la forêt et à assurer la coordination avec l'aménagement du territoire.
Sa durée de validité a été fixée à 20 ans afin d'assurer une continuité dans la manière de gérer les forêts.
L'attribution d'une fonction prioritaire à une zone forestière représente la volonté d'action et le traitement futur de la forêt à long terme.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
Cette couche centralise tous les relevés existants d'arbres isolés situés hors forêts sur la canton de Genève.
Elle est le résultat de la digitalisation de l'inventaire "historique" de 1976, mis à jour régulièrement par les collectivités.
C'est une mise à plat de la base relationnelle ICA avec une sélection de champs du dernier relevé sur un arbre.
Attention de prendre en compte la précision du positionnement des ponctuels de cette couche.
- Les arbres relevés dans les années 70' (sur plan papier) ont une précision de positionnement d'environ 25 mètres
- Les arbres issus d'un relevé de terrain plus récent (et plus précis) ont une précision de positionnement proche du mètre.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
INVENTAIRE CANTONAL DES ARBRES POUR CONSULTATION EN LIGNE
Consultation par géoservices | PointCouche de l'Inventaire Cantonal des Arbres isolés hors forêts utilisée par le guichet cartographique de la Ville de Genève.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
L'inventaire forestier de Genève a été effectué en 2004. Ses objectifs sont les suivants:
Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des massifs boisés (par exemple la structure des classes d'âge, la répartition des essences, les volumes de bois et la production de bois, etc.)
Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des différentes fonctions assignées à la forêt (présence de la faune, lumière au sol, départs d'érosion, images forestières, dégâts humains, etc.)
Les surfaces inventoriées sont délimitées par le tracé du cadastre forestier. Les surfaces de moins de 2 hectares ont été éliminées automatiquement et les cordons boisés trop étroits ont été enlevés manuellement.
L'inventaire est basé sur la méthode d'échantillonnage systématique par placettes temporaires. Il s'agit d'une grille callée sur les coordonnées nationales (une placette pour deux hectares et d'un rayon allant de 9 à 13 mètres en fonction de la densité des tiges).
1597 placettes ont été inventoriées pour 3000 hectares de forêt.
Le précédent inventaire a eu lieu en 1985.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
L'inventaire forestier de Genève a été effectué en 2004. Ses objectifs sont les suivants:
Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des massifs boisés (par exemple la structure des classes d'âge, la répartition des essences, les volumes de bois et la production de bois, etc.)
Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des différentes fonctions assignées à la forêt (présence de la faune, lumière au sol, départs d'érosion, images forestières, dégâts humains, etc.)
Les surfaces inventoriées sont délimitées par le tracé du cadastre forestier. Les surfaces de moins de 2 hectares ont été éliminées automatiquement et les cordons boisés trop étroits ont été enlevés manuellement.
L'inventaire est basé sur la méthode d'échantillonnage systématique par placettes temporaires. Il s'agit d'une grille callée sur les coordonnées nationales (une placette pour deux hectares et d'un rayon allant de 9 à 13 mètres en fonction de la densité des tiges).
1597 placettes ont été inventoriées pour 3000 hectares de forêt.
Le précédent inventaire a eu lieu en 1985.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
L'inventaire forestier de Genève a été effectué en 2004. Ses objectifs sont les suivants:
- Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des massifs boisés (par exemple la structure des classes d'âge, la répartition des essences,les volumes de bois et la production de bois, etc.)
- Fournir les données de base et de contrôle pour la gestion pérenne des différentes fonctions assignées à la forêt (présence de la faune, lumière au sol, départs d'érosion, images forestières, dégâts humains, etc.)
Les surfaces inventoriées sont délimitées par le tracé du cadastre forestier. Les surfaces de moins de 2 hectares ont été éliminées automatiquement et les cordons boisés trop étroits ont été enlevés manuellement.
L'inventaire est basé sur la méthode d'échantillonnage systématique par placettes temporaires. Il s'agit d'une grille calée sur les coordonnées nationales (une placette pour deux hectares et d'un rayon allant de 9 à 13 mètres en fonction de la densité des tiges).
1597 placettes ont été inventoriées pour 3000 hectares de forêt.
Le précédent inventaire a eu lieu en 1985.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
Les noms locaux désignent des petites parties de paysage qui ont été reprises de l'usage linguistique local. Les noms locaux portent par exemple : des noms de forêts, de pâturages, de prairies, de champs.
Cette donnée historique comporte les noms locaux de Genève et leur périmètre qui ont été saisis entre 1936 et 1959 ainsi que quelques modifications réalisées jusqu'à fin 2023.
La donnée actuelle et mise à jour en continu est la couche:SITG_ADM.CAD_NOMS_LOCAUX
NOMS LOCAUX ET LIEUX-DITS
 | Polygone
| Polygone
Les noms locaux ou lieux-dits désignent des petites parties du territoire qui ont été reprises dans l'usage linguistique local.
Les noms locaux portent des noms de forêts, de pâturages, de prairies, de champs. Ils ont été déduits des peuplements (noms de fermes) ou affichent des dénominations historiques.
Ils sont présents par exemple : sur le plan de ville ou sur le plan de base de la mensuration officielle.
La forêt est utilisée par la société de différentes manières et à diverses intensités.
La fonction Coeur_Usages définit les intensités acceptables ou planifiées. Les activités sont RÉGULÉES dans les aires dans lesquelles la protection du milieu forestier est prioritaire comme dans les réserves ;
elles sont TOLEREES dans la majorité des peuplements ;
elles peuvent être AMENAGEES dans les endroits dans lesquels des infrastructures ont été créés à cet effet ;
elles peuvent enfin revêtir un caractère ACCRU sur des surfaces limitées :
- ACCRU PARTICULIER : dédiées à des activités particulières limitant les autres usages (comme le tir à l'arc, le vélo de descente, le lasergame, etc.) ;
- ACCRU GÉNÉRAL : dans lesquels la pression du public est simplement plus forte (places de pique-nique, zones de liberté pour chiens, etc.).
La forêt exerce différentes catégories de fonctions en relation avec la biodiversité: coeur_nature.
Les RESERVES sont des espaces au bénéfice d'une protection légale renforcée ; les NOYAUX NATURE ont une surface et une profondeur capables d'héberger la faune sauvage alors que les RELAIS NATURE sont plutôt des lieux de passage.
La production de bois est l'une des fonctions de base demandée à la forêt. Certaines surfaces, les SANCTUAIRES, sont exclues de cette fonction et aucun bois n'y est récolté.
Dans d'autres, seul le bois abattu pour des objectifs de biodiversité est VALORISE.
Dans le reste de la forêt la PRODUCTION est assurée dans le cadre d'une sylviculture proche de la nature.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
En fonction de leur distance au centre ville, les différents espaces du canton peuvent être répartis en diverses situations.
Le Centre est le coeur de la cité. La couronne entoure le centre et est également densément bâti. La périphérie est constituée par des zones plus ouvertes à l'urbanisation peu dense.
Les bourgs, zones villas et hameaux font partie de cette catégorie car ils offrent un caractère urbanisé qui influe sur les fonctions de la forêt.
L'espace rural inclut tant les espaces agricoles que les écosystèmes ou milieux naturels.
A la différence du Plan Directeur Cantonal, le tissu bâti des hameaux et des villages n'en fait pas partie en raison de ses interactions spécifiques avec la forêt .
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
Le réseau GEnevois d'Observation des Sols (GEOS) a pour objectif de réaliser un monitoring à long terme de l'évolution des teneurs en polluants du sol et plus généralement de sa fertilité. Le réseau est constitué de 103 sites de prélèvements représentatifs du territoire genevois. On y réalise tous les cinq ans des prélèvements à une profondeur de 20 cm depuis la surface. Les analyses de monitoring réalisées sur ces prélèvements portent notamment sur qualité des sols (pH, matière organique (MO) et rapport MO/Argile). Des analyses permettant la caractérisation des sites sont réalisées une fois sur chaque site (granulométrie, nutriments, calcaire et capacité d'échange cationique (CEC) effective).
Les sites d'échantillonnage sont fixes, les prélèvements sont effectués exactement au mêmes endroits d'une campagne à l'autre. Ceci permet d'évaluer l'évolution des différents paramètres analysés au cours du temps, en s'affranchissant de leur possible variabilité spatiale. De plus, les sites sont représentatifs de l'occupation des sols du canton. Ils ont été répartis dans huit catégories ans un souci de proportionnalité par rapport à l'occupation de la surface totale des sols du Canton: Grandes Cultures (GC), Cultures Maraîchères (CM), Viticultures (VI), Arboriculture (AR), Prairies (PR), Forêts (FO), Parcs et Jardins (PJ) et Sites Naturels (SN).
La couche GOL_GEOS_PORTRAIT contient les résultats d'analyses de caractérisation des 103 sites actifs. Ce sont les analyses qui ne sont réalisées qu'une fois par site lorsque le site entre dans le réseau GEOS. Les analyses concernent la granulométrie du sol, les taux de nutriments présents dans le sol, le carbonate, la capacité d'échange cationique effective et la capacité d'échange cationique potentielle ainsi que toutes les composantes liées à la CEC. La CEC effective est une analyse qui a été introduite plus récemment pour remplacer la CEC potentielle. Les sites les plus anciens du réseau ont fait l'objet d'un second prélèvement pour déterminer la CEC effective. On n'analyse plus la CEC potentielle pour les sites qui entrent dans le réseau depuis 2010.
GEOS a été instauré en 1990 par le Laboratoire Cantonal d'Agronomie de Genève aujourd'hui rattaché à la Hate Ecole du Paysage, d'Ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA), dans le Groupe Sols et Substrats. Des prélèvements ont eu lieu en 1990 (campagne 1990-1994), 1995 (campagne 1995-1999) et 2000 (campagne 2000-2004). En 2010, le GESDEC (Service de Géologie, Sols et Déchet) mandate officiellement le groupe Sols et Substrats de HEPIA pour remettre en oeuvre le suivi du réseau GEOS dans le cadre d'application de l'Ordonnance fédérale sur les atteintes portées aux sols (OSol). Deux campagnes ont depuis été réalisées (de 2010 à 2016 puis de 2017 à 2022).
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service