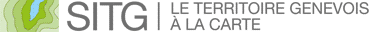Catalogue
ESPACE MINIMAL DES COURS D'EAU
 | Polygone
| Polygone
L'espace minimal est constitué à partir d'une composante liquide, solide et nature.
La composante liquide est issue de la carte indicative des dangers (CID), le couloir de crue et les zones de stockage proches du cours d'eau.
La composante solide est délimitée à partir des zones instables au bord des cours d'eau.
La composante nature est une largeur définie sur la base d'une liste d'espèces faunistiques typique du cours d'eau.
L'espace issu de la superposition des ces couches est ensuite confronté aux constructions existantes afin de le diminuer aux endroits 'perdus' pour le cours d'eau
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
ESPACES INTERDITS AUX CHIENS
 | Polygone
| Polygone
Le 17 juin 2007, le peuple genevois a voté, avec une forte majorité, d'importantes modifications de la loi sur la détention des chiens. Celles-ci prévoient notamment que certains lieux publics doivent être interdits aux chiens.
Cette démarche permet ainsi de satisfaire les différentes attentes des usagers de l'espace public :
si les chiens et leurs propriétaires peuvent bénéficier de prérogatives dans certaines zones - les espaces de liberté pour chiens - ils doivent également admettre des restrictions dans d'autres.
Certains parcs sont ainsi interdits aux chiens afin d'y garantir la tranquillité et la sécurité du public et notamment des enfants.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
FONCTION DU PLAN DIRECTEUR FORESTIER
 | Polygone
| Polygone
Le Plan Directeur Forestier représente le faîte de la planification forestière. Il vise à défendre les intérêts publics propres à la forêt et à assurer la coordination avec l'aménagement du territoire.
Sa durée de validité a été fixée à 20 ans afin d'assurer une continuité dans la manière de gérer les forêts.
L'attribution d'une fonction prioritaire à une zone forestière représente la volonté d'action et le traitement futur de la forêt à long terme.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
GARES SCHEMA D'AGGLOMERATION 3
 | Point
| Point
Schéma d'agglomération de 3ème génération (2016)
- les gares avec desserte nationale ou internationale constituent les noeuds principaux du réseau ferroviaire d'agglomération : elles desservent les zones les plus denses et offrent des correspondances optimales entre des différents niveaux d'offres (RER, RE, IR, IC, ICN, international) et les réseaux urbains.
- les gares avec desserte régionale ou RER desservent des zones urbaines denses et certains centres locaux et bénéficient de rabattement locaux.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
INDICE D'ECOPOTENTIALITE URBAINE PAR COMMUNE
 | Polygone
| Polygone
L'indice d'écopotentialité urbaine permet d'évaluer le degré potentiel de biodiversité d'un territoire. Il est constitué de 8 indicateurs et mesure la capacité d'accueil en biodiversité d'un milieu urbain en fonction de la présence de structures - naturelles ou aménagées - favorables à la biodiversité.
Dans le milieu urbain, la biodiversité est contrainte par l'influence humaine dans un contexte de mutation territoriale. Il existe donc un enjeu fort de conservation et d'aménagement des espaces verts en ville, afin de lutter contre la perte et la banalisation des espèces, et de conserver la variété, la taille et la connectivité des espaces semi-naturels urbains. Dans ce contexte, les Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève (CJB) collaborent depuis 2014 avec l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN) dans le but de proposer des outils cartographiques utiles à la prise en considération de cette ressource au travers des planifications directrices et localisées. L'écopotentialité est un lot d'indicateurs synthétique de l'état de la biodiversité pour un périmètre donnée (commune, quartier, zone d'affectation). Il a été réfléchi afin de mettre en avant les points forts et les points faibles de la zone d'étude et donc de faire un lien intéressant avec l'aménagement futur.
L'indice est construit sur la base de 8 indicateurs normalisés, c'est-à-dire que chaque plage de valeur des indicateurs est ramenée à une plage normée entre 0 et 1 de manière à permettre une représentation agrégée des 8 indicateurs:
1) Densité de toitures végétalisées (m2/m2) : évaluation de la proportion de surface de toiture végétalisée par rapport aux surfaces bâties d'un périmètre donné.
2) Surface perméable (%) : évaluation du pourcentage de surface de milieux perméables par rapport aux surfaces imperméables
3) Diversité des milieux verts : regroupement des milieux en 8 catégories assurant des fonctions différentes pour la biodiversité, puis calcul d'un indice de diversité en milieux verts.
4) Densité d'arbres (nb/ha): Nombre d'arbre issu de l'identification via des données LIDAR auxquels s'ajoutent les surfaces forestières (densité moyenne de 370 arbres/ha).
5) Fragmentation: Mesure la fragmentation du paysage par la présence de barrières physiques (routes, zones bâties, etc.) pour le déplacement de la faune et de la flore entre deux points.
6) Naturalité : Indice compris entre +/- l'infini, qui distingue les milieux qui ont conservé leurs qualités naturelles (valeurs positives élevées), des milieux affecté par les activités humaines (valeurs négatives élevées).
7) Diversité de milieux aquatiques et humides: regroupement des milieux aquatiques en 8 catégories assurant des fonctions différentes pour la biodiversité, puis calcul d'un indice de diversité en milieux aquatiques.
8) Surface milieux aquatiques: évaluation de la surface de milieu aquatique et humide occupés par rapport à la surface de la zone d'intérêt.
Les données de base utilisées lors des analyses sont notamment la carte des milieux naturels et la couche toitures végétalisées (SIPV_MN_CARTO_5, SIPV_EV_TOIT_VERT).
L'indice permet de faire un lien intéressant avec l'aménagement et la gestion du territoire en identifiant les facteurs manquants ou favorables à la biodiversité sur le périmètre considéré. Les périmètres d'étude vont de l'échelle de la commune, jusqu'à la zone d'aménagement (1500m2).
C'est pourquoi, cet indice a été intégré en annexe du guide de densification de la zone 5 (zone villa) publié par l'Office de l'urbanisme en 2017. Il est par ailleurs utilisé par les communes et leurs mandataires dans le cadre de la révision des plans directeurs communaux et des plans guides des Grands projets.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
L'Infrastructure Ecologique genevoise (IE) découle de l'objectif 11 d'Aichi définis dans le Plan Stratégique mondial (CBD, 2010), repris par la confederation et la SBG30.
L'infrastructure écologique est le résultat de l'utilisation d'un logiciel de priorisation spatiale (Zonation).
L'algorithme de Zonation part de l'ensemble des cellules (résolution de 25x25m) d'un territoire donné et supprime à chaque itération la cellule avec la plus petite perte globale de potentiel estimé de biodiversité, pour produire une carte de priorité spatiale classée par ordre d'importance relative pour la protection de la biodiversité (classée entre 1 et 100).
Les inputs sont variés et traitent de la biodiversité de facon multidimensionnelle.
La carte COMPOSITION traite des donnnées d'observation d'espèces faune et flore et de la composition en milieux naturels.
Elle est couvrante sur le territoire, des valeurs faibles indiquent que la zone se situe dans un cold spot de biodiversité.
A l'inverse des valeurs élevées (supérieures à 70 sur 100) indiquent que la zone fait partie des hot spot de biodiversité.
L'Infrastructure Ecologique genevoise (IE) découle de l'objectif 11 d'Aichi définis dans le Plan Stratégique mondial (CBD, 2010), repris par la confederation et la SBG30.
L'infrastructure écologique est le résultat de l'utilisation d'un logiciel de priorisation spatiale (Zonation).
L'algorithme de Zonation part de l'ensemble des cellules (résolution de 25*25m) d'un territoire donné et supprime à chaque itération la cellule avec la plus petite perte globale de potentiel estimé de biodiversité, pour produire une carte de priorité spatiale classée par ordre d'importance relative pour la protection de la biodiversité (classée entre 1 et 100).
Les inputs sont variés et traitent de la biodiversité de facon multidimensionnelle.
La carte CONNECTIVITE traite des donnnées d'analyse de connectivité pour des espèces faunistiques (cerf, crapaud commun, lièvre) et de trame noire.
Elle est couvrante sur le territoire, des valeurs faibles indiquent des éléments du territoire dont la connectivité a été dégradée, susceptibles d'empêcher les espèces de se déplacer.
A l'inverse des valeurs élevées (supérieures à 70 sur 100) indiquent que la zone fait partie des éléments favorable à la connectivité des espèces.
l'Infrastructure Ecologique genevoise (IE) découle de l'objectif 11 d'Aichi définis dans le Plan Stratégique mondial (CBD, 2010), repris par la confederation et la SBG30.
L'infrastructure écologique est le résultat de l'utilisation d'un logiciel de priorisation spatiale (Zonation).
L'algorithme de Zonation part de l'ensemble des cellules (résolution de 25*25m) d'un territoire donné et supprime à chaque itération la cellule avec la plus petite perte globale de potentiel estimé de biodiversité, pour produire une carte de priorité spatiale classée par ordre d'importance relative pour la protection de la biodiversité (classée entre 1 et 100).
Les inputs sont variés et traitent de la biodiversité de facon multidimensionnelle.
La carte SERVICE ECOSYSTEMIQUE traite des bienfaits rendus par la nature en lien avec la biodiversité (séquestration du carbone, abondance des pollinisateurs, régulation du microclimat, contrôle de l'érosion, protection contre les crues, cultures intéressantes pour la biodiversité, qualité de l'eau et de l'air).
Elle est couvrante sur le territoire, des valeurs faibles indiquent que peu de service sont rendu.
A l'inverse des valeurs élevées (supérieures à 70 sur 100) indiquent que la zone fournis de nombreux services différents.
l'Infrastructure Ecologique genevoise (IE) découle de l'objectif 11 d'Aichi définis dans le Plan Stratégique mondial (CBD, 2010), repris par la confederation et la SBG30.
L'infrastructure écologique est le résultat de l'utilisation d'un logiciel de priorisation spatiale (Zonation).
L'algorithme de Zonation part de l'ensemble des cellules (résolution de 25*25m) d'un territoire donné et supprime à chaque itération la cellule avec la plus petite perte globale de potentiel estimé de biodiversité, pour produire une carte de priorité spatiale classée par ordre d'importance relative pour la protection de la biodiversité (classée entre 1 et 100).
Les inputs sont variés et traitent de la biodiversité de facon multidimensionnelle.
La carte STRUCTURE traite des donnnées de structure du paysage à savoir des indices basés sur la carte des milieux naturels de Genève tells que la fragmentation des milieux, la perméabilité, la naturalité ou encore la diversité des milieux.
Elle est couvrante sur le territoire, des valeurs faibles indiquent des éléments du territoire dont la fonctionnalité a été dégradée, susceptibles d'empêcher les espèces de se déplacer.
A l'inverse des valeurs élevées (supérieures à 70 sur 100) indiquent que la zone fait partie des éléments favorable à la fonctionnalité des habitats.
l'Infrastructure Ecologique genevoise (IE) découle de l'objectif 11 d'Aichi définis dans le Plan Stratégique mondial (CBD, 2010), repris par la confederation et la SBG30.
Il s'agit de mettre en périmètre protégé 17% de zone terrestre de haute qualité biologique. Toutefois, pour assurer la protection de la biodiversité cantonale, ces hotspots ne se suffisent pas. En effet, selon le Forum Biodiversité Suisse 13 % de zone supplémentaire sont encore nécessaires pour assurer une mise en réseau cohérente, mais aussi la fonctionnalité des écosystèmes et fournir des services écosystémique (SE) tout en participant à la prospérité économique, sociale et environnementale de la population.
L'infrastructure écologique est le résultat de l'utilisation d'un logiciel de priorisation spatiale (Zonation).
L'algorithme de Zonation part de l'ensemble des cellules (résolution de 25*25m) d'un territoire donné et supprime à chaque itération la cellule avec la plus petite perte globale de potentiel estimé de biodiversité, pour produire une carte de priorité spatiale classée par ordre d'importance relative pour la protection de la biodiversité (classée entre 1 et 100).
Les inputs sont variés et traitent de la biodiversité de facon multidimensionnelle afin d'en estimer la qualité, en compilant des informations d'habitat, de richesse spécifique de structure et fonction des écosystèmes et de service écosystémique.
La carte DIAGNOSTIC BIODIVERSITE est couvrante sur le territoire, des valeurs faibles indiquent que la zone se situe dans un cold spot de biodiversité pour lequel apporter une amélioration serait bénéfique.
A l'inverse des valeurs élevées (supérieures à 70 sur 100) indiquent que la zone fait partie des objectifs de protection pour laquelle il faudra être vigilant si un projet d'aménagement voit le jour. Les zones de valeurs intermédiaires n'ont pas moins d'intérêt puisqu'elles peuvent être à l'interface entre des zones de haute qualité et venir les dégrader risquerait de com
INONDATION CONDITIONNELLE
 | Polygone
| Polygone
Par inondation, on entend le débordement d'un cours d'eau hors de son lit. Le caractère plus ou moins dangereux des inondations dépend de la hauteur d'eau et de la force du courant atteinte, ainsi que de la quantité de matériaux charriés.
La détermination des zones d'inondation se fait par rapport à la topographie. Pour certaines zones, l'apparition d'inondations dépend de conditions particulières concomitantes au déroulement de l'évènement de crue, comme: les embâcles sous les ponts et passerelles, la rupture d'un ouvrage de protection ou les courbes de remous aux points de confluence des cours d'eau ou du lac.
Les périodes de retour pour lesquelles les zones d'inondation ont été déterminées sont de 30, 100 et 300 ans et pour certains cours d'eau 2 et 10 ans. Les zones d'inondation conditionnelle sont représentatives des conditions particulières décrites ci-dessus.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
INONDATION TEMPS DE RETOUR 10 ANS
 | Polygone
| Polygone
Par inondation, on entend le débordement d'un cours d'eau hors de son lit. Le caractère plus ou moins dangereux des inondations dépend de la hauteur d'eau et de la force du courant atteinte, ainsi que de la quantité de matériaux charriés.
La détermination des zones d'inondation se fait par rapport à la topographie. Pour certaines zones, l'apparition d'inondations dépend de conditions particulières concomitantes au déroulement de l'évènement de crue, comme: les embâcles sous les ponts et passerelles, la rupture d'un ouvrage de protection ou les courbes de remous aux points de confluence des cours d'eau ou du lac.
Les périodes de retour pour lesquelles les zones d'inondation ont été déterminées sont de 30, 100 et 300 ans et pour certains cours d'eau 2 et 10 ans. Les zones d'inondation conditionnelle sont représentatives des conditions particulières décrites ci-dessus.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
INONDATION TEMPS DE RETOUR 100 ANS
 | Polygone
| Polygone
Par inondation, on entend le débordement d'un cours d'eau hors de son lit. Le caractère plus ou moins dangereux des inondations dépend de la hauteur d'eau et de la force du courant atteinte, ainsi que de la quantité de matériaux charriés.
La détermination des zones d'inondation se fait par rapport à la topographie. Pour certaines zones, l'apparition d'inondations dépend de conditions particulières concomitantes au déroulement de l'évènement de crue, comme: les embâcles sous les ponts et passerelles, la rupture d'un ouvrage de protection ou les courbes de remous aux points de confluence des cours d'eau ou du lac.
Les périodes de retour pour lesquelles les zones d'inondation ont été déterminées sont de 30, 100 et 300 ans et pour certains cours d'eau 2 et 10 ans. Les zones d'inondation conditionnelle sont représentatives des conditions particulières décrites ci-dessus.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
INONDATION TEMPS DE RETOUR 2 ANS
 | Polygone
| Polygone
Par inondation, on entend le débordement d'un cours d'eau hors de son lit. Le caractère plus ou moins dangereux des inondations dépend de la hauteur d'eau et de la force du courant atteinte, ainsi que de la quantité de matériaux charriés.
La détermination des zones d'inondation se fait par rapport à la topographie. Pour certaines zones, l'apparition d'inondations dépend de conditions particulières concomitantes au déroulement de l'évènement de crue, comme: les embâcles sous les ponts et passerelles, la rupture d'un ouvrage de protection ou les courbes de remous aux points de confluence des cours d'eau ou du lac.
Les périodes de retour pour lesquelles les zones d'inondation ont été déterminées sont de 30, 100 et 300 ans et pour certains cours d'eau 2 et 10 ans. Les zones d'inondation conditionnelle sont représentatives des conditions particulières décrites ci-dessus.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
INONDATION TEMPS DE RETOUR 30 ANS
 | Polygone
| Polygone
Par inondation, on entend le débordement d'un cours d'eau hors de son lit. Le caractère plus ou moins dangereux des inondations dépend de la hauteur d'eau et de la force du courant atteinte, ainsi que de la quantité de matériaux charriés.
La détermination des zones d'inondation se fait par rapport à la topographie. Pour certaines zones, l'apparition d'inondations dépend de conditions particulières concomitantes au déroulement de l'évènement de crue, comme: les embâcles sous les ponts et passerelles, la rupture d'un ouvrage de protection ou les courbes de remous aux points de confluence des cours d'eau ou du lac.
Les périodes de retour pour lesquelles les zones d'inondation ont été déterminées sont de 30, 100 et 300 ans et pour certains cours d'eau 2 et 10 ans. Les zones d'inondation conditionnelle sont représentatives des conditions particulières décrites ci-dessus.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service