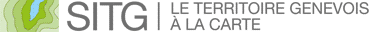Catalogue
SECTEURS D'ETUDE CONCERNANT LES SURELEVATIONS DE BATIMENTS
Consultation par géoservices | Polygone15 secteurs représentant les 4 étapes de cartographie des cartes indicatives relatives à la surélévation de bâtiments.
Ces cartes ont été adoptées par le Conseil d'Etat.
Les bâtiment spécialement indiqués sur ces cartes sont susceptible d'être surélevés au sens des articles 23 et 27 de la LCI (loi 10088).
La couche des surélévations se repose sur les informations plus précises décrites dans le guide suivant:
https://www.ge.ch/document/surelevation-immeubles-logements-methode-evaluation
Cette carte est à disposition pour indiquer une potentialité de surélévation de certains immeubles.
SYNTHURBA - MODIFICATIONS DE ZONE
Uniquement partenaires SITG | PolygoneLes modifications de limite de zone (MZ) modifient le plan de zone, plan d'affectation général qui définit les règles de constructions par zones pour l'ensemble du territoire cantonal. La couche SYNTHURBA_MZ recense les MZ à l'étude ou en cours de procédure et les MZ adoptées disposant encore d'un potentiel à bâtir.
Les périmètres sont représentés. Les informations disponibles sont extraites des écrans synoptiques, suivi, statistiques, synthèse de la base de données SYNTHURBA (SYNTHESE URBANISATION) : elles permettent d'identifier la dénomination, l'avancement ou les capacités d'accueil, initiales et restantes des MZ.
SYNTHURBA - PLANS DIRECTEURS DE ZONE INDUSTRIELLE
Uniquement partenaires SITG | PolygoneLes plans directeurs en zone de développement industriel (PDZI) sont des plans d'affectation spéciaux qui prescrivent les règles d'aménagement dans les zones de développement industriel (voirie, infrastructures...). La couche SYNTHURBA_PDZI recense les PDZI à l'étude ou en cours de procedure et les PDZI asoptés disposant encore d'un potentiel à bâtir.
Les périmètres sont représentés. Les informations disponibles sont extraites des écrans synoptiques, suivi, statistiques, synthèse de la base de données SYNTHURBA (SYNTHESE URBANISATION) : elles permettent d'identifier la dénomination, l'avancement ou les capacités d'accueil, initiales et restantes des PDZI.
SURFACES D'ASSOLEMENT
 | Polygone
| Polygone
Les surfaces d'assolement (SDA) font partie du territoire qui se prête à l'agriculture. Elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables.
L'objectif est d'aider à l'examen des requêtes en zone agricole et de gérer les surfaces dans le but de la préservation des SDA.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
SECTEURS DE PROTECTION DES EAUX
 | Polygone
| Polygone
Cette couche définit les secteurs dont le contexte géographique, géologique et hydrogéologique impliquent des mesures de précaution et des aménagements limitant les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines destinées à l'eau de boisson.
- Le secteur Ao est défini pour les eaux superficielles. Il est cantonné sur les rives du lac Léman ainsi que sur certaines zones considérées comme biotopes d'importance nationale.
- Le secteur Au de protection des eaux comprend toutes les surfaces correspondant aux aquifères formés de roches meubles, qui sont le siège de nappes d'eaux souterraines exploitables dignes de protection, ainsi que celles des zones attenantes nécessaires à leur protection.
- Le secteur B de protection des eaux est une particularité genevoise mise en place avec l'accord de l'OFEV pour indiquer des zones particulièrement menacées, mais se situant sous une épaisseur de couche morainique protectrice suffisante.
Ce secteur permet de protéger les aquifères d'objets qui pourraient, en fonction de leur emprise en profondeur, créer un risque sur la ressource (parking souterrain à plusieurs niveaux, sondes géothermiques) sans pénaliser des objets prévus se limitant à un développement en surface ou à faible profondeur sans atteinte possibles pour la nappe (citernes, sous-sol d'immeuble, etc.). Ces secteurs se retrouvent au-dessus de l'extension des nappes d'eau souterraines principales du domaine public.
Une illustration relative au secteur B est disponible dans la partie "Informations complémentaires" de cette fiche.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
SECTEURS DE RAMONAGE
 | Polygone
| Polygone
Les secteurs de ramonage, appellés également arrondissements, au nombre de sept, délimitent les zones d'intervention pour les travaux de ramonage effectués par des entreprises spécialisées, concessionnaires.
Les émanations de fumées sont contrôlées périodiquement, conformément aux dispositions fédérales (OPair).
La sécurité civile assure la saisie informatique de tous ces prélèvements pour un suivi de conformité sur plus de 35 000 installations de chauffage.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
SECTEURS DES TECHNICIENS ARBRES
 | Polygone
| Polygone
Répartition régionale des techniciens arbres - Secteurs
Les zones représentées permettent de situer les régions rattachées aux secteurs arbres, de connaître les communes attribuées aux différents périmètre en vue de faciliter les contacts avec les personnes en charge du secteur.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
SECTEURS FORESTIERS
 | Polygone
| Polygone
Le canton est subdivisé en secteurs forestiers dénommés triages; le nombre de triages et leur délimitation sont fixés par l'office cantonal de facon à permettre une gestion rationnelle et durable des forêts publiques et privées qui les composent.
Ces triages sont placés sous la responsabilité de spécialistes forestiers au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience pratique, au sens de l'article 51 de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991.
Les zones représentées permettent de situer les régions rattachées aux différents techniciens forestiers.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
SITE PRIORITAIRE BRYOPHYTE
 | Polygone
| Polygone
Les bryophytes (classiquement appelées "mousses") sont des organismes passant facilement inapercus et dont l'identification n'est possible que par quelques expert(e)s sur le canton.
Les sites prioritaires pour les bryophytes synthétisent les zones dignes de protection pour ce groupe. Ces sites sont définis sur la base des connaissances des expert(e)s du canton quant aux espèces rares et menacées. L'intérêt de travailler par site et non par espèce permet une lecture facilitée pour les usagers.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
SOLS DE FONDATION
 | Polygone
| Polygone
Quatre zones d'aléa sismique ont été définies en Suisse et Genève fait partie de la zone 1, qui est celle où le risque sismique est le plus faible.
Classe A :
Roche tendre sous une couverture maximale de 5 mètres de sol lâche.
Classe B :
Dépôts de sables et graviers cimentés d'une épaisseur de plus de 30 mètres.
Classe C :
Dépôts de graviers et sables normalement consolidés et non cimentés et/ou matériel morainique, d'une épaisseur de plus de 30 mètres.
Classe D :
Dépôts de sables fins, silts ou argiles non consolidés, d'une épaisseur de plus de 30 mètres.
Classe E :
Couches superficielles des classes de sol de fondation C ou D d'une épaisseur comprise entre 5 et 30 mètres, surmontant une couche plus rigide des classes de sol de fondation A ou B.
Classe F1 :
Dépôts organiques d'une épaisseur supérieure à 10 mètres ou décharge d'ordure ménagère épaisse.
Classe F2 :
Glissement de terrain profond (>2 mètres) actif ou susceptible d'être réactivé.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
L'Infrastructure Ecologique genevoise (IE) découle de l'objectif 11 d'Aichi défini dans le Plan Stratégique mondial (CBD, 2010), repris par la confédération et la SBG30.
Il s'agit de mettre en périmètre protégé 17% de zone terrestre de haute qualité biologique. Toutefois, pour assurer la protection de la biodiversité cantonale, ces hotspots ne se suffisent pas.
En effet, selon le Forum Biodiversité Suisse, 13 % de zone supplémentaire sont encore nécessaires pour assurer une mise en réseau cohérente, mais aussi la fonctionnalité des écosystèmes et fournir des services écosystémique (SE) tout en participant à la prospérité économique, sociale et environnementale de la population.
La donnée présentée ici est dérivée des couches FFP_IE_DIAGNOSTIC_BIODIVERSITE, FFP_IE_STRUCTURE, FFP_IE_CONNECTIVITE, et FFP_IE_SERVICE_ECOSYSTEMIQUES. Il s'agit de leur conversion d'un format raster vers un format vecteur puis de leur compilation dans une unique couche.
Les polygones sont de forme hexagonale de 100m de hauteur pour faciliter la visualisation et représentent la valeur moyenne observée dans les couches originales.
Les informations contenues dans la couche sont variés et traitent de la biodiversité de facon multidimensionnelle afin d'en estimer la qualité. Sont compilés des informations d'habitat et de richesse spécifique (pilier composition), de structure des écosystèmes (pilier structure), de fonction des écosystèmes (pilier connectivité) et de service écosystémique (pilier service écosystémique).
Des valeurs faibles par pilier indiquent que la zone n'est plus fonctionnelle pour le pilier en question. A l'inverse des valeurs élevées (supérieures à 70 sur 100) indiquent que la zone est de grande importance pour le pilier en question. Les zones de valeurs intermédiaires n'ont pas moins d'intérêt puisqu'elles peuvent être à l'interface entre des zones de haute qualité et venir les dégrader risquerait de compromettre la fonctionnalité des écosystèmes.
Cette aggrégation d'informations facilite ainsi la compréhension du diagnostic de la biodiversité et de son état de santé.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
L'Infrastructure Ecologique genevoise (IE) découle de l'objectif 11 d'Aichi défini dans le Plan Stratégique mondial (CBD, 2010), repris par la confédération et la SBG30.
Il s'agit de mettre en périmètre protégé 17% de zone terrestre de haute qualité biologique. Toutefois, pour assurer la protection de la biodiversité cantonale, ces hotspots ne se suffisent pas.
En effet, selon le Forum Biodiversité Suisse, 13 % de zone supplémentaire sont encore nécessaires pour assurer une mise en réseau cohérente, mais aussi la fonctionnalité des écosystèmes
et fournir des services écosystémique (SE) tout en participant à la prospérité économique, sociale et environnementale de la population.
La donnée présentée ici est dérivée des couches FFP_IE_DIAGNOSTIC_BIODIVERSITE, FFP_IE_STRUCTURE, FFP_IE_CONNECTIVITE, et FFP_IE_SERVICE_ECOSYSTEMIQUES.
Il s'agit de leur conversion d'un format raster vers un format vecteur puis de leur compilation dans une unique couche.
Les polygones sont de forme hexagonale de 12.5m de hauteur pour faciliter la visualisation et représentent la valeur moyenne observée dans les couches originales.
Les informations contenues dans la couche sont variées et traitent de la biodiversité de facon multidimensionnelle afin d'en estimer la qualité.
Sont compilés des informations d'habitat et de richesse spécifique (pilier composition), de structure des écosystèmes (pilier structure), de fonction des écosystèmes (pilier connectivité) et de service écosystémique (pilier service écosystémique).
Des valeurs faibles par pilier indiquent que la zone n'est plus fonctionnelle pour le pilier en question. A l'inverse des valeurs élevées (supérieures à 70 sur 100) indiquent que la zone est de grande importance pour le pilier en question. Les zones de valeurs intermédiaires n'ont pas moins d'intérêt puisqu'elles peuvent être à l'interface entre des zones de haute qualité et venir les dégrader risquerait de compromettre la fonctionnalité des écosystèmes.
Cette aggrégation d'informations facilite ainsi la compréhension du diagnostic de la biodiversité et de son état de santé.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WMS : accéder au service
L'Infrastructure Ecologique genevoise (IE) découle de l'objectif 11 d'Aichi défini dans le Plan Stratégique mondial (CBD, 2010), repris par la confédération et la SBG30.
Il s'agit de mettre en périmètre protégé 17% de zone terrestre de haute qualité biologique. Toutefois, pour assurer la protection de la biodiversité cantonale, ces hotspots ne se suffisent pas.
En effet, selon le Forum Biodiversité Suisse, 13 % de zone supplémentaire sont encore nécessaires pour assurer une mise en réseau cohérente, mais aussi la fonctionnalité des écosystèmes et fournir des services écosystémique (SE) tout en participant à la prospérité économique, sociale et environnementale de la population.
La donnée présentée ici est dérivée des couches FFP_IE_DIAGNOSTIC_BIODIVERSITE, FFP_IE_STRUCTURE, FFP_IE_CONNECTIVITE, et FFP_IE_SERVICE_ECOSYSTEMIQUES. Il s'agit de leur conversion d'un format raster vers un format vecteur puis de leur compilation dans une unique couche.
Les polygones sont de forme hexagonale de 200m de hauteur pour faciliter la visualisation et représentent la valeur moyenne observée dans les couches originales.
Les informations contenus dans la couche sont variées et traitent de la biodiversité de facon multidimensionnelle afin d'en estimer la qualité. Sont compilés des informations d'habitat et de richesse spécifique (pilier composition), de structure des écosystèmes (pilier structure), de fonction des écosystèmes (pilier connectivité) et de service écosystémique (pilier service écosystémique).
Des valeurs faibles par pilier indiquent que la zone n'est plus fonctionnelle pour le pilier en question. A l'inverse des valeurs élevées (supérieures à 70 sur 100) indiquent que la zone est de grande importance pour le pilier en question. Les zones de valeurs intermédiaires n'ont pas moins d'intérêt puisqu'elles peuvent être à l'interface entre des zones de haute qualité et venir les dégrader risquerait de compromettre la fonctionnalité des écosystèmes.
Cette aggrégation d'informations facilite ainsi la compréhension du diagnostic de la biodiversité et de son état de santé.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
L'Infrastructure Ecologique genevoise (IE) découle de l'objectif 11 d'Aichi défini dans le Plan Stratégique mondial (CBD, 2010), repris par la confédération et la SBG30.
Il s'agit de mettre en périmètre protégé 17% de zone terrestre de haute qualité biologique. Toutefois, pour assurer la protection de la biodiversité cantonale, ces hotspots ne se suffisent pas.
En effet, selon le Forum Biodiversité Suisse, 13 % de zone supplémentaire sont encore nécessaires pour assurer une mise en réseau cohérente, mais aussi la fonctionnalité des écosystèmes et fournir des services écosystémique (SE) tout en participant à la prospérité économique, sociale et environnementale de la population.
La donnée présentée ici est dérivée des couches FFP_IE_DIAGNOSTIC_BIODIVERSITE, FFP_IE_STRUCTURE, FFP_IE_CONNECTIVITE, et FFP_IE_SERVICE_ECOSYSTEMIQUES. Il s'agit de leur conversion d'un format raster vers un format vecteur puis de leur compilation dans une unique couche.
Les polygones sont de forme hexagonale de 25m de hauteur pour faciliter la visualisation et représentent la valeur moyenne observée dans les couches originales.
Les informations contenues dans la couche sont variées et traitent de la biodiversité de facon multidimensionnelle afin d'en estimer la qualité. Sont compilés des informations d'habitat et de richesse spécifique (pilier composition), de structure des écosystèmes (pilier structure), de fonction des écosystèmes (pilier connectivité) et de service écosystémique (pilier service écosystémique).
Des valeurs faibles par pilier indiquent que la zone n'est plus fonctionnelle pour le pilier en question. A l'inverse des valeurs élevées (supérieures à 70 sur 100) indiquent que la zone est de grande importance pour le pilier en question. Les zones de valeurs intermédiaires n'ont pas moins d'intérêt puisqu'elles peuvent être à l'interface entre des zones de haute qualité et venir les dégrader risquerait de compromettre la fonctionnalité des écosystèmes.
Cette aggrégation d'informations facilite ainsi la compréhension du diagnostic de la biodiversité et de son état de santé.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service
L'Infrastructure Ecologique genevoise (IE) découle de l'objectif 11 d'Aichi défini dans le Plan Stratégique mondial (CBD, 2010), repris par la confédération et la SBG30.
Il s'agit de mettre en périmètre protégé 17% de zone terrestre de haute qualité biologique. Toutefois, pour assurer la protection de la biodiversité cantonale, ces hotspots ne se suffisent pas.
En effet, selon le Forum Biodiversité Suisse, 13 % de zone supplémentaire sont encore nécessaires pour assurer une mise en réseau cohérente, mais aussi la fonctionnalité des écosystèmes et fournir des services écosystémique (SE) tout en participant à la prospérité économique, sociale et environnementale de la population.
La donnée présentée ici est dérivée des couches FFP_IE_DIAGNOSTIC_BIODIVERSITE, FFP_IE_STRUCTURE, FFP_IE_CONNECTIVITE, et FFP_IE_SERVICE_ECOSYSTEMIQUES. Il s'agit de leur conversion d'un format raster vers un format vecteur puis de leur compilation dans une unique couche.
Les polygones sont de forme hexagonale de 50m de hauteur pour faciliter la visualisation et représentent la valeur moyenne observée dans les couches originales.
Les informations contenues dans la couche sont variés et traitent de la biodiversité de facon multidimensionnelle afin d'en estimer la qualité. Sont compilés des informations d'habitat et de richesse spécifique (pilier composition), de structure des écosystèmes (pilier structure), de fonction des écosystèmes (pilier connectivité) et de service écosystémique (pilier service écosystémique).
Des valeurs faibles par pilier indiquent que la zone n'est plus fonctionnelle pour le pilier en question. A l'inverse des valeurs élevées (supérieures à 70 sur 100) indiquent que la zone est de grande importance pour le pilier en question. Les zones de valeurs intermédiaires n'ont pas moins d'intérêt puisqu'elles peuvent être à l'interface entre des zones de haute qualité et venir les dégrader risquerait de compromettre la fonctionnalité des écosystèmes.
Cette aggrégation d'informations facilite ainsi la compréhension du diagnostic de la biodiversité et de son état de santé.
Voir la fiche complète
Ouvrir la donnée dans la carte
- Esri ArcGIS Rest : accéder au service
- WFS : accéder au service