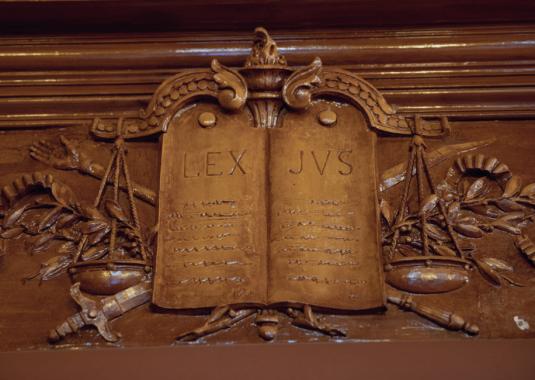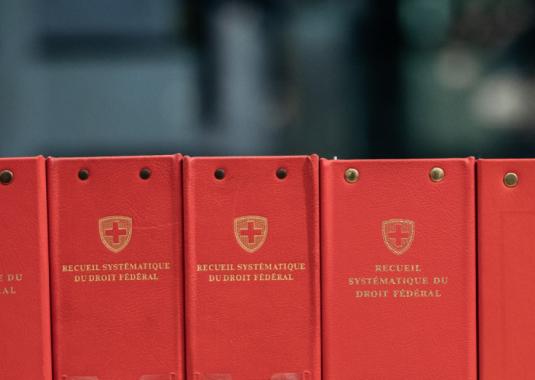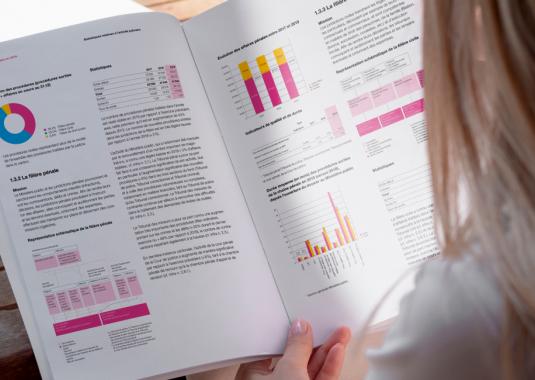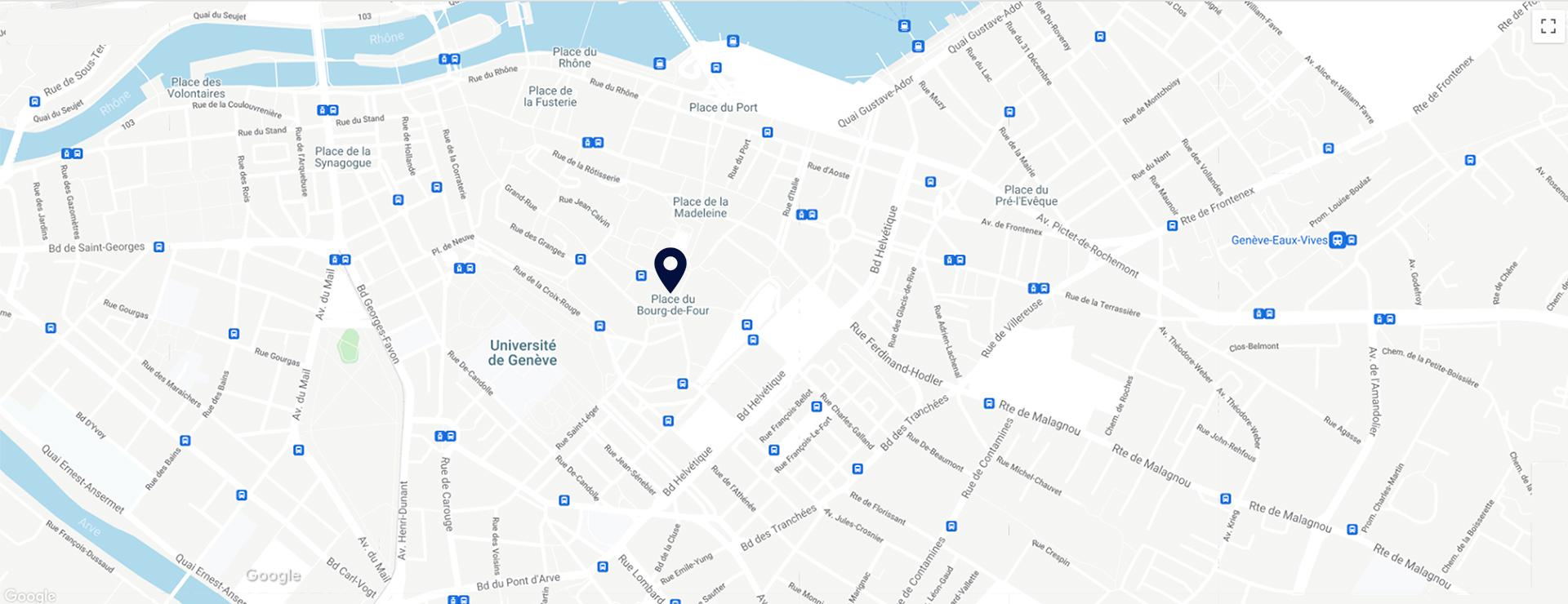Formulaires
Questions fréquentes
- Je souhaite déposer une plainte pénale, comment dois-je procéder?
- Je souhaite rendre visite à une détenue ou un détenu, comment dois-je faire?
- Comment obtenir un certificat d'héritier?
- Je souhaite postuler, comment procéder? Quels sont les documents utiles?
- J'ai besoin d'une ou d'un interprète lors d'une audience, qui dois-je contacter?
Actualités

22/04/24
Information du Pouvoir judiciaire
Ouverture et fermeture des greffes et des bureaux du Pouvoir judiciaire le 1er mai 2024

27/03/24
Communiqué de presse - Ministère public
Homicide des Charmilles: Tribunal criminel saisi

26/03/24
Communiqué de presse - Cour de justice